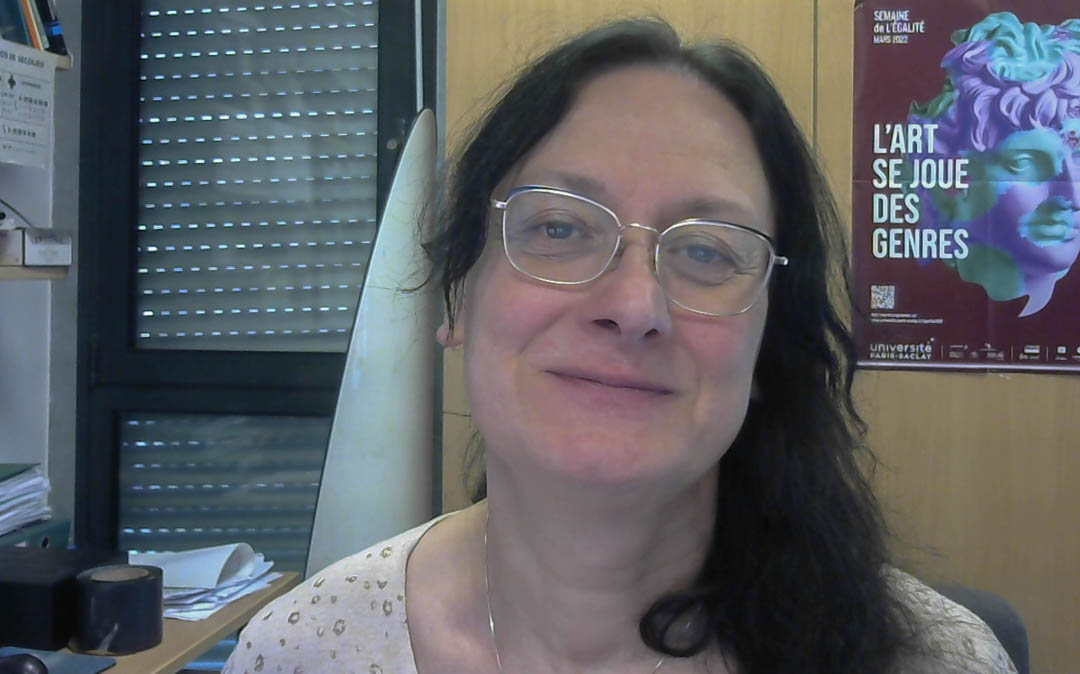Enseignante et ingénieure de recherche en réalité augmentée, Jeanne Vézien a pu compter sur son environnement professionnel pour affirmer sa transidentité. Pragmatique, elle dépeint un milieu universitaire ouvert, dans lequel sa transition est un « quasi non-événement ».
Par Aimée Le Goff
« Mes premiers souvenirs de dysphorie de genre remontent à l’âge de quatre ou cinq ans. Je me revois ensuite à l’âge de 11 ans, à la bibliothèque en train de chercher à comprendre pourquoi j’ai envie de porter les robes de ma mère ». Pour Jeanne Vézien, enseignante et chercheuse en réalité virtuelle et augmentée pour le CNRS, il aura fallu attendre cinquante ans pour, enfin, mettre des mots sur sa transidentité, après une existence passée « dans l’art du déguisement ».
Atmosphère de considération
Jeanne Vézien exerce au sein du laboratoire universitaire de Paris-Saclay, aujourd’hui cogéré par le CNRS et le LISN (Laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique). Depuis plus de trente ans, elle est spécialiste des sujets liés à l’interface homme-machine. Un domaine qui implique « beaucoup de facteurs cognitifs » ainsi qu’une « considération certaine envers l’humain ». « Cela rend les choses globalement plus faciles », estime la scientifique. Quand il est question d’aborder son coming out — terme qu’elle n’apprécie guère — la chercheuse se dit favorisée. « J’ai eu la chance d’avoir une sorte de préparation par rapport à mon passé académique, et je travaille dans un laboratoire qui favorise les relations sociales. Il y a une charte de bonne conduite, un effort particulier est fait en faveur de l’inclusivité LGBTQI +. On baigne ici dans une atmosphère de considération ».
Une « goutte d’eau dans la citerne »
En 2018, Jeanne est mariée, père de trois enfants. En début d’année, elle commence à ressentir un malaise profond, sans idée de facteur déclencheur. « Je n’y arrivais simplement plus. C’était une goutte d’eau dans la citerne, une conjonction de facteurs personnels sans événements dramatiques ». Plus tard, Jeanne identifiera ces moments comme des crises de dysphorie de genre : « J’étais très mal à l’aise quand on me genrait au masculin, j’ai commencé à vouloir être socialement considérée comme une femme ». À la fin de l’année, le malaise est invalidant. Il empiète sur toute activité. Une visite chez le médecin et une prise en charge psychologique l’amènent à la décision salvatrice de démarrer une transition. « J’ai abordé cela comme un nouveau sujet d’expérimentation, ce qui a été une vraie force ».
Un milieu qui implique l’ouverture aux autres
Il serait regrettable d’écrire son portrait sans mentionner que Jeanne Vézien est une personne délicate, soucieuse du bien-être d’autrui. En 2019, la chercheuse laisse passer l’été, attend la rentrée universitaire pour communiquer sur son identité. « Je l’ai expliqué à mes collègues comme n’importe quel phénomène scientifique. Je voulais présenter les choses sous une forme objective, lucide. Mon esprit d’analyse m’a protégée, d’une certaine façon ». Méthodique, elle organise une cinquantaine d’entretiens, individuels ou groupés. « Mes collègues étaient assez intrigué·es, mais je crois que tout le monde a compris. C’était presque un non-événement ».
Elle rédige ensuite une lettre qu’elle fait diffuser par la direction. Là encore, les réactions sont positives. Jeanne explique cette bienveillance par plusieurs facteurs : le travail de recherche disciplinaire du milieu dans lequel elle évolue, qui « implique une ouverture aux autres », et la crédibilité professionnelle bâtie durant sa carrière. À ce sujet, elle estime qu’un discours professionnel crédible, construit pendant des années, aide à bénéficier d’une écoute attentive. « La situation est plus facile dans le cas d’une transition tardive, car on a une forme d’assise ». Quand elle évoque son environnement de travail, elle sourit : « nous avons quand même un certain nombre de personnages, avec une diversité de comportements et d’apparences. Si demain, je vois un·e collègue arriver avec un nez de clown, je pourrais très bien m’imaginer qu’il s’agit d’une nouvelle expérimentation ».
Bouleversement familial et misogynie ordinaire
La scientifique l’affirme sans hésiter, ce solide appui professionnel l’a aidée à « tenir », notamment face au bouleversement de sa vie personnelle. Si ses ami·es sont encore là, elle a dû divorcer et quitter la maison. Elle se considère encore aujourd’hui comme le père de ses enfants. Le premier de la fratrie avait 14 ans lors de son coming out. « Pour le deuxième, ça a été. Le troisième ne me parle presque plus. J’étais préparée à ce genre de drame familial, mais quand on me demande rétrospectivement pourquoi j’ai fait ça, c’est un Everest de culpabilité ».
Autre chose, dans la vie de Jeanne, a changé. Légèrement. Quelque chose d’à peine marqué, mais bien là : « Depuis ma transition, je remarque que je suis un peu moins écoutée. Dans les grandes réunions, les hommes s’affirment plus facilement. C’est une forme de misogynie très légère. À nous, les femmes, d’apprendre à parler aussi fort ». Elle conclut : « la transition de genre est aussi un plaidoyer pour l’égalité entre les hommes et les femmes ».
Protéger des parents aimants
Au fil de notre entretien, Jeanne reconnaît l’hostilité de certains milieux professionnels à l’égard des personnes transgenres, pointe du doigt les courants idéologiques d’extrême droite comme des ennemis certains. Mais, là encore, la chercheuse se montre attentive aux « mécanismes de réaction » d’autrui. Et concède volontiers : « quand on n’a jamais connu d’oppression, on ne peut pas toujours s’imaginer la réalité des autres. Avant, j’étais dans la majorité sociale. Je vivais comme un homme cisgenre, j’avais les enfants, le chien, le jardin. Je sais le confort et l’aveuglement que cela peut provoquer ».
Lorsqu’elle repense aux robes qu’elle rêvait de porter, petite, elle s’interroge : sa mère soupçonnait-elle quelque chose ? « Je me le demanderai toute ma vie. Elle ne m’a jamais rien dit. J’ai eu des parents aimants, je me suis sans doute empêchée d’être moi-même par considération pour eux. Ils sont nés avant la Seconde Guerre mondiale. Tout ceci, pour eux, ça aurait été du chinois ».